Comment les enseignants peuvent-ils aider les élèves ayant des difficultés à apprendre les mathématiques? Résumé du webinaire et idées de ressources avec la docteure Barbara Dougherty - Partie 2
- Joanna McKay

- 23 mai 2025
- 8 min de lecture
Vanessa Rayner and Joanna McKay
Notre deuxième journée avec la docteure Barbara Dougherty a continué avec une concentration sur les Six Recommandations tiré du module intitulé : Aider des élèves ayant des difficultés en mathématiques : mesures d’intervention selon le Guide pratique de l’éducateur pour les classes élémentaires. Ces recommandations sont basées sur des études de recherche de haute qualité, fondées sur des preuves et axées sur l’enseignement des mathématiques de niveau 1 :

La session a commencé en force avec une tâche mathématique riche intitulée : « Lequel n’est pas à sa place? » Les participants ont trouvé une règle pour expliquer pourquoi chacun des quatre nombres n’étaient pas à leur place.
La discussion a porté sur la mise en relation des nombres en fonction de leurs caractéristiques (pairs, impairs, carrés), de leurs chiffres, de leur composition (premiers, composés) et d’autres façons d’exprimer ces nombres (facteurs premiers, par exemple). Il est clair que cette tâche simple est accessible à tous les élèves, quel que soit leur niveau scolaire. L’activité a également mis en évidence l’importance de la Recommandation 2, à savoir apprendre aux élèves à utiliser un langage mathématique concis et clair. Consultez le lien pour trouver des problèmes similaires!
La session du jour était axée sur l’identification et la compréhension des structures multiplicatives et sur la représentation des fractions.
Nous avons commencé par une activité de tirage de cartes qui impliquait l’analyse de la structure des problèmes sous forme d’énoncé (Recommandation 5), afin d’orienter notre discussion sur la différence qui existe entre les structures multiplicatives et additives, et de comprendre comment identifier ces structures dans les problèmes sous forme d’énoncé. Nous devions en outre rédiger une équation correspondant à la structure du problème.
Ce n’était pas une tâche facile!

Cependant, il est apparu clairement qu’enseigner aux élèves comment analyser un problème sous forme d’énoncé en fonction de sa structure est une stratégie qui permet d’éviter d’utiliser la stratégie (inefficace) du mot clé pour déterminer l’opération. Nous avons appris que :
les structures additives impliquent l’addition ou la soustraction de quantités ayant la même unité. Bien que le type d’unité soit le même, les unités ne doivent pas nécessairement être de la même taille, ce qui signifie qu’une quantité peut être composée de parties de tailles différentes.

4 pommes + 2 pommes = 6 pommes (l’unité est les pommes)
4 pommes + 2 poires = 4 pommes et 2 poires (l’unité est le fruit)
Les structures multiplicatives impliquent la multiplication ou la division de quantités avec différentes unités. Lorsqu’elles sont multipliées, les différents types d’unités sont coordonnés pour représenter des groupes de taille égale (par exemple, les miles par heure).
6 assiettes x 4 biscuits = 24 biscuits
Lorsque je coordonne des assiettes (un type d’unité) et des biscuits (un autre type d’unité), je compte 6 unités de 4, ou des biscuits par assiette (l’unité coordonnée).

Comprendre la multiplication comme une coordination d’unités nous a permis de réaliser que la multiplication n’est pas une addition répétée.. Il est nécessaire de souligner la signification de la multiplication car l’addition répétée ne peut pas être utilisée pour multiplier tous les nombres rationnels (essayez d’utiliser l’addition répétée pour multiplier deux fractions, par exemple).
En outre, percevoir la signification de la multiplication aidera également les enseignants à faire comprendre aux élèves qu’une unité désigne ce que représente le chiffre 1, mais n’a pas toujours une valeur de 1 (par exemple, 1 unité de 4). Alors, comment enseigner ce concept mathématique fondamental?
En effet, la docteure Dougherty a indiqué qu’une stratégie efficace pour améliorer la compréhension des problèmes sous forme d’énoncé consiste à aider les élèves à visualiser le problème à l’aide du modèle Concret-Représentation-Abstrait (CRA; Recommandation 3).
Les élèves manipulent d’abord du matériel concret, puis apprennent à établir des liens entre les représentations concrètes et semi-concrètes (dessins, diagrammes, etc.) pour finalement utiliser les représentations concrètes et semi-concrètes en relation avec les représentations abstraites, telles que les nombres et les symboles mathématiques.
En commençant par le concret, nous avons utilisé des assiettes en papier et des pions pour montrer la multiplication 3 x 4 et nous avons été invités à répondre à la question suivante : « Comment les élèves ont-ils trouvé 12 comme réponse?» La façon dont les élèves déterminent le produit est très révélatrice.
les élèves peuvent compter chaque pion individuellement (faible niveau, ils ne voient pas qu’il s’agit de groupes de taille égale) OU
compter par bond (compter par groupes de taille égale et donc apprendre à multiplier et à diviser les nombres).
Conformément à la Recommandation 1 nous avons progressivement travaillé sur différents types de problèmes afin de nous concentrer sur la représentation des problèmes sous forme d’énoncé, sachant que la représentation visuelle (Recommandation 3) permet d’approfondir la compréhension des structures des problèmes sous forme d’énoncé (Recommandation 5) et, ce qui est tout aussi important, aide les élèves à « voir » l’opération à utiliser ainsi que la relation entre les valeurs connues et les valeurs inconnues. En d’autres termes, les recommandations sont clairement interconnectées. Dans cet exemple, l’acquisition et l’approfondissement progressifs de la compréhension de la signification et des processus de multiplication et de division des nombres (Recommandation 1) sont soutenus par l’interconnexion des Recommandations 3 et 5. L’enchaînement systématique (par ordre de difficulté) des types de problèmes était le suivant :
Groupement égal (type de problème le moins difficile) : problème du produit inconnu, ou 3 x 4= ▢
Groupement égal : taille du groupe inconnue, ou 3 x ▢ = 9
Groupement égal : nombre de groupes inconnus, ou or ▢ X 5 = 15
Comparaison multiplicative : trouver le montant le plus élevé en utilisant le groupe de référence (plus petit montant en jaune ci-dessous) et la relation multiplicative entre les montants comparés, ou 4 x 3= ▢

Comparaison multiplicative (type de problème le plus difficile) : trouver le montant de référence (ou le montant le plus petit) en utilisant le montant le plus élevé et la relation multiplicative entre les montants comparés, ou 5 x ▢ = 20

La modélisation des actions et des relations décrites dans le problème et l’établissement de liens entre les symboles et les représentations concrètes nous ont aidés à nous concentrer sur la structure du problème sous forme d’énoncé et à comprendre les similitudes et les différences entre ces types de problèmes. Que nous modélisions les montants en problèmes sous forme d’objets discrets dénombrables (tels que des jetons à deux faces) ou que nous représentions les montants sous forme de quantité continue à l’aide de droites numériques et de réglettes Cuisenaire, la grande idée est que les problèmes à structure multiplicative illustrent la façon dont les nombres sont composés et peuvent être décomposés en groupes de taille égale, ou en unités. Les mathématiques ne sont pas un sport de spectateurs - les élèves doivent s’impliquer pour comprendre les grandes idées fondamentales des mathématiques!
Nous avons également discuté de la différence qui existe entre la fluidité en mathématiques, ou de l’utilisation fluide de stratégies efficaces et précises, et l’automaticité, ou des faits qui sont mémorisés et, dont on peut facilement se rappeler. Il est intéressant de noter, et conformément à la Recommandation 6, que les deux sont nécessaires pour soutenir les trois phases de la fluidité : (a) Phase 1 : promotion de la mémorisation des faits fondamentaux, (b) Phase 2 : enseignement de stratégies qui utilisent les faits fondamentaux dont sont dérivés d’autres faits, ce qui aboutit finalement à l’automaticité, ou (c) Phase 3.
Comment la résolution de problèmes sous forme d’énoncé avec des structures multiplicatives aide-t-elle les élèves à acquérir la maîtrise des faits de multiplication? La résolution de problèmes sous forme d’énoncé favorise
la modélisation, le dessin, le comptage par bonds et la recherche de modèles, ce qui aide les élèves à automatiser les faits fondamentaux.
Par exemple, le codage couleur d’un tableau des centaines facilite la recherche et le partage de tous les motifs possibles. Quelles régularités remarquez-vous lorsque nous comptons par bonds de 2 et de 4 le long du tableau des centaines?

Les élèves peuvent également développer des stratégies relatives aux faits dérivés (par exemple, trouver un quasi-double, doubler, ajouter un groupe, etc.) grâce à des jeux mathématiques tels que le Quad Squad (le groupe de quatre), Get Four Numbers in a Row (Compte quatre chiffres d’affilée), parce qu’ils ciblent la fluidité, le sens des nombres et la stratégie.
Les élèves peuvent également développer des stratégies relatives aux faits dérivés (par exemple, trouver un quasi-double, doubler, ajouter un groupe, etc.) grâce à des jeux mathématiques tels que le Quad Squad (le groupe de quatre), Get Four Numbers in a Row (Compte quatre chiffres d’affilée), parce qu’ils ciblent la fluidité, le sens des nombres et la stratégie.
La modélisation et l’utilisation du vocabulaire mathématique approprié (Recommandation 2) sont souvent négligées. Combien de fois entendons-nous des élèves (et des enseignants) nommer une fraction « 3 sur 4 » au lieu de « 3 quarts »? Ou encore, utiliser un langage qui est à la fois inexact sur le plan mathématique et peu répandu. L’exemple ci-dessous évite d’enseigner aux élèves la signification des fractions et remplace le vocabulaire mathématique tel que le dénominateur par le mot « pantalon ».

L’utilisation abusive du langage est sans aucun doute un facteur qui entrave l’apprentissage et ne conduit qu’à la confusion, et devrait être évitée.
L’utilisation abusive du langage est sans aucun doute un facteur qui entrave l’apprentissage et ne conduit qu’à la confusion, et devrait être évitée.
Chaque outil permet aux élèves de comprendre la signification des fractions de différentes manières. Par exemple, les barres des fractions permettent, entre autres, de mettre l’accent sur la relation qui existe entre les fractions unitaires et l’unité. Cependant, les réglettes Cuisenaire jouent ce rôle, et bien plus encore! Par exemple, les quintes peuvent être représentées à l’aide d’unités de différentes tailles, comme la tige orange, la tige jaune et une combinaison de tiges (par exemple, 2 bâtons orange et 1 bâton jaune). Favoriser cette flexibilité et renforcer la compréhension d’autres concepts clés (par exemple, composer une fraction à l’aide du bâtonnet de fraction de l’unité appropriée) fait partie intégrante de la comparaison des fractions, de la compréhension de l’équivalence des fractions, de la simplification des fractions... la liste est non exhaustive!
Lorsqu’il utilise les réglettes Cuisenaire pour comparer des fractions, l’élève doit comprendre que les deux fractions doivent avoir la même unité. Ce concept peut être négligé lors de la comparaison de fractions ayant le même dénominateur et peut être difficile à comprendre lorsque les dénominateurs sont différents, en particulier si les fractions ne sont pas représentées de manière concrète ou semi-concrète. L’utilisation des réglettes Cuisenaire apprend aux élèves à être stratégiques dans le choix de l’unité, car celle-ci doit être utilisée pour représenter les deux fractions. Non seulement cela aide à construire des connaissances procédurales (par exemple, trouver un dénominateur commun) à partir d’une compréhension conceptuelle, mais l’utilisation des réglettes Cuisenaire pour comparer des fractions (par exemple, des fractions avec le même numérateur mais des dénominateurs différents) met en lumière ce qui est comparé. En effet, une fois que les fractions sont représentées à l’aide de réglettes de taille et de couleur différentes, il est évident que nous comparons la taille des fractions unitaires et non le nombre de fractions unitaires (ce qui est le cas lorsque l’on compare des fractions ayant le même dénominateur).
Avant de pouvoir utiliser les réglettes Cuisenaire pour comparer des fractions, nous devons garder à l’esprit la Recommandation 1, et construire et relier la signification partie-tout des fractions à la comparaison des fractions. Barb nous a guidés dans cette démarche en nous faisant réaliser une série de tâches à l’aide des réglettes Cuisenaire afin de développer notre compréhension et notre flexibilité en utilisant les bâtonnets pour se concentrer sur l’unité lorsqu’il s’agit de donner un sens à la notion de fractions.
Une partie de l’intégration de la Recommandation 3 dans l’enseignement des fractions dépend également de l’exploration des outils qui peuvent être utilisés avec les différents modèles (surface, longueur et ensemble). Si les réglettes Cuisenaire et les barres de fractions constituent d’excellents modèles de longueur, d’autres outils tels que les blocs à motifs et les tangrams permettent de montrer l’importance d’utiliser des modèles d’aire qui vont au-delà des cercles (ou des pizzas) et des rectangles (ou des tablettes de chocolat). L’exploration de nombreux outils différents représentant le modèle d’aire ne peut qu’aider les élèves à transférer cette compréhension à d’autres situations mathématiques et de la vie réelle!
Nous sommes reconnaissants à Barb pour cette session riche en contenu et pratique. Ce qu’elle a partagé a donné vie au manuel intitulé les six recommandations et nous avons pu voir clairement comment nous pouvions les mettre en pratique et soutenir tous nos élèves, en particulier ceux qui ont des difficultés à apprendre les mathématiques.



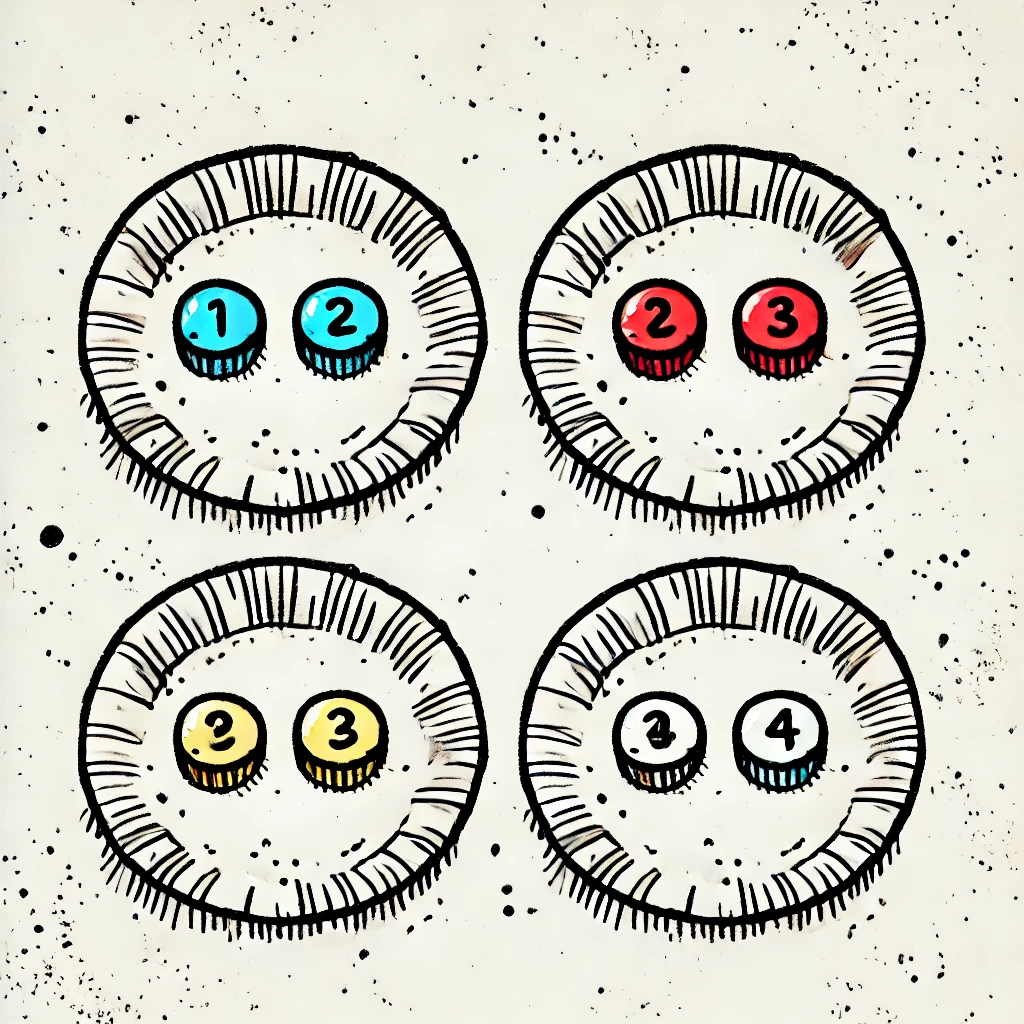









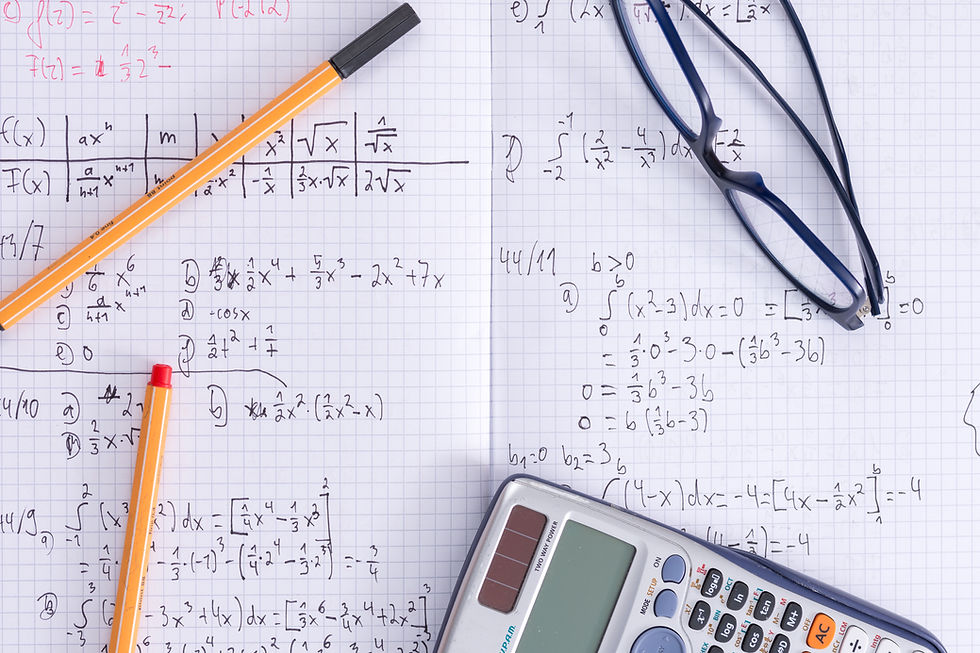
Commentaires